
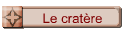
Les progrès de la connaissance
Les sources antiques
Représentation du paysage
Le volcanisme antique
Représentation des volcans
La fertilité volcanique
Le cratère
Phénomènes sans feu
Matériaux volcaniques
Pinacotheca (images)
Textes antiques
Bibliographie
Contact
Liens
Sommaire de la page par hyperliens :
Situé au sommet, le cratère est la bouche de sortie des matériaux volcaniques : ponces, cendres, lave en fusion. Tirés de l’image du vase grec, les mots crater en latin et kratµhr en grec sont presque les seuls termes techniques propres au volcanisme. A propos de l’Etna, Solin définit justement ce qu’est un « cratère » avec l’image du trou, de l’ouverture dans le sol (hiatus) : Au sommet de l’Etna, il y a deux ouvertures, que l’on appelle cratères. Mais en général, pour le cratère central, les auteurs choisissent l’image de la bouche éruptive, avec os en latin et stéoma en grec ; pour des cratères mineurs, on trouve aussi stéomion. L’idée de la bouche éruptive est la plus forte, car elle induit celle du vomissement de matériaux, du jaillissement de flammes.
Les auteurs antiques savent qu’il peut y avoir plusieurs cratères sur un volcan, dont des cratères mineurs, qui peuvent ne pas être sommitaux : c’est le cas de l’Etna qui, comme le dit Strabon, tantôt se concentre en un seul cratère, tantôt se divise , ce qui a pour conséquence une multiplication des orifices à la surface du sol, c’est-à-dire des cratères. Les Anciens ont remarqué qu’il y a aussi des sortes de fissures ou d’anfractuosités, par lesquelles s’échappent d’ordinaire des fumerolles, comme le décrit l’Etna : Partout se sont formées des fissures, partout le sol s’est entrouvert. L’Etna oppose dans un balancement structurel les vastes ouvertures (hinc vasti aditus) et les étroits orifices (…hinc artos penitus) mais les deux types sont caractérisés par leur profondeur. La vue peut être inversée quand c’est l’activité éruptive, et non son résultat, qui est au cœur de la description : quand l’Etna décrit la formation d’un cratère lors d’une éruption, c’est un amoncellement (congeries) de matériaux projetés hors de la bouche et non plus le vide qui est évoqué : Mais à mesure que les pierres tombent les unes sur les autres, elles forment un amoncellement qui peu à peu s’élève et se termine en un sommet étroit.
Grâce au témoignage de voyageurs qui ont gravi l’Etna, sur lequel il fonde une très bonne description, Strabon a décrit avec une grande précision les différents éléments du cratère, ainsi que ses dimensions, ce qui a permis de penser qu’il parlait de l’ancien cratère principal du volcan, appelé Piano del Trafoglietto, de 3,7 km de diamètre, à 6 km au sud-est du sommet actuel. Strabon utilise les termes &ofréuw, bounéow, pedéion. Il y a donc un talus circulaire (&ofréuw) qui entoure un vaste espace plat, désigné par le terme pedéion. Ce talus est en cendre volcanique et il a des parois abruptes, car ceux qui veulent le passer doivent sauter pour prendre pied sur le plat : Ils avaient trouvé au sommet un plateau uni, d’environ 20 stades de circonférence, circonscrit par un fort talus de cendre de la hauteur d’un mur ordinaire, au bas duquel il fallait sauter si l’on voulait ensuite s’avancer sur le plateau. Au centre de l’espace plat se dresse le cône éruptif (bounéow) : Au milieu, ils avaient vu une sorte de butte cendrée de la même couleur que le plateau. L’Etna est donc bien connu des Anciens, qui le gravissaient par intérêt scientifique, comme nous l’avons vu. Pline a même précisé la circonférence de son cratère : Le cratère a 20 stades de tour .
La forme du Vésuve semble nettement moins bien précisée par les sources antiques. Avant l’éruption de 79, jamais les auteurs n’évoquent un grand cratère comme celui d’aujourd’hui. Strabon parle au contraire d’un sommet presque plat avec seulement des sortes de crevasses dans une roche couleur de suie, au milieu des cendres, seuls indices volcaniques : le Vésuve a un sol semé de creux avec une expression d’autant plus forte qu’elle est pléonastique : <Le sol> présente des fissures qui s’ouvrent comme des pores.
Il semble donc que le Vésuve n’ait pas eu la même forme sommitale qu’aujourd’hui, avant l’éruption explosive de 79 ap. J.-C, souvent qualifiée significativement de conflagratio par Suétone. D’ailleurs, quand Stace et Valérius Flaccus, par exemple, évoquent le Vésuve, ils écrivent volontiers Vesuvinus/Vesuui apex, évoquant ainsi l’aspect conique du Vésuve et la partie sommitale de la montagne avant l'éruption de 79. La célèbre peinture de la Maison du Centenaire à Pompéi, sur laquelle nous allons revenir, présente elle aussi un Vésuve au sommet conique unique, sans cratère sommital apparent, ressemblant au premier abord à toutes les autres montagnes représentées sur les fresques pompéiennes :
fresque du Vésuve de la Maison du Centenaire, à Pompéi, IX, 8, 3-6. La peinture se trouve au Musée de Naples, inv. n°11286. Elle mesure 140 x 101 cm
Mais si l’on regarde la peinture de très près, il semble qu’on puisse discerner un, voire deux cratères secondaires sur les flancs de la montagne (flèches bleues). Or certains vulcanologues pensent que le sommet du Vésuve se serait ouvert lors de l’énorme éruption de 79 et il se serait créé un grand cratère intérieur qui est justement décrit par des auteurs antiques postérieurs aux événements. En effet, Dion Cassius fait justement la distinction entre l’ancienne forme du sommet et celle qui s’est ouverte et qui, elle, ne change plus au moment où il écrit, employant le terme de géométrie du cercle, kéuklow. Il explique que le feu a rongé la partie centrale de la montagne sans en entamer les bords et qu’il est devenu concave (koµilon), faisant un parallélisme significatif entre la forme du cratère et un grand amphithéâtre. Procope, plus tardif, est encore plus précis : Le sommet est abrupt et très difficile à gravir. Mais au sommet du Vésuve, à peu près au centre, il y a une cavité d’une telle profondeur que l’on croit qu’elle descend jusqu’au pied de la montagne . Ce qu’il décrit ressemble fort au cratère actuel, c’est-à-dire à un cratère ouvert largement et profond, ce que ne citait en aucun cas Strabon au Ier siècle. Orose, un peu plus tard, utilise le mot uertex pour désigner le sommet abrupt et vertigineux de la montagne. Ce n’est évidemment pas le même cratère exactement, puisqu’il y a eu de multiples éruptions importantes entre 79 et 1944 (date de la dernière éruption du Vésuve), qui ont modelé ce cratère.
Ainsi, c’est sous la forme d’une montagne à sommet unique et stérile que presque tous les auteurs antiques le décrivent, que ce soit de façon littéraire ou iconographique
Le Mont Argée de Cappadoce pose la question de la présence imagée du cratère et sur son mode de représentation numismatique. Sous le sommet ou au sommet, selon les monnaies, il y a un cercle vide, dessiné sous le sommet :

Revers de monnaie de Septime Sévère : le Mont Argée de Cappadoce (Sydenham 400 var)
Un type inusuel, seulement émis entre 112 et 117, sous el règne de Trajan, montre la montagne avec, semble-t-il, un cratère qui apparaît sous forme de U ouvert très largement vers le ciel, d’autant plus qu’on peut y discerner ce qui ressemble à des flammes qui montent

Revers de didrachme émis sous Trajan : le Mont Argée de Cappadoce. Egalement de ce type : Syd. 207 = BMC 80
Le débat sur cette interprétation reste ouvert. Historiquement, les types de représentation avec un potentiel cratère sommital ou souterrain avec ou sans flammes (ou lave) pourraient correspondre à une période d’activité accrue du volcan qu’il faudrait établir précisément et scientifiquement. Sur les sources numismatiques, il apparaît que le massif du Mont Argée était largement couvert d’arbres ; cela correspond à la seule description littéraire qui subsiste : Strabon écrit que l’Argée est couvert de forêts sur tout son pourtour, ce qui permet aux habitants de Mazaca d’en exploiter le bois à portée de main. Comme nous avons pu le voir auparavant d’après les monnaies et sur le poids de balance, la couverture arborée est très représentative du massif, et on offre en offrande au dieu de la montagne des paniers de pommes de pins, pour le remercier de l’exploitation fructueuse de son bois.
